En 2026, nous fêterons le tricentenaire de la naissance de Philidor, et sa ville natale, Dreux, organisera plusieurs évènements. Et ce sera l'occasion pour moi de publier plusieurs articles sur Philidor.
Dans ce présent article je souhaite mettre en lumière le travail remarquable d'un jeune Maître International, Benjamin Defromont, également étudiant en philosophie. Il s'agit de son mémoire de Master 2 au sujet de Philidor intitulé "Genèse des idées échiquéennes de François-André Philidor : L’Analyse des échecs à la lumière des théories ramistes".
Benjamin, que je remercie, m'a autorisé à le publier sur mon blog, et je le mettrai très prochainement à disposition sur le site de la FFE. Vous trouverez donc dans cet article un résumé du travail de Benjamin, une entrevue et le texte intégral de son mémoire (à la fin de cet article), qui contient des documents inédits concernant Philidor.
Benjamin Defromont en mai 2023 à Gournay-en-Bray
quand il réalisa sa 2ème norme de MI
Résumé du mémoire
Benjamin Defromont, jeune Maître International, a soutenu le 30 juin 2023 à la
Sorbonne Université, un mémoire de Master 2 en musicologie, intitulé
"Genèse des idées échiquéennes de François-André Philidor : L'Analyse des
échecs à la lumière des théories ramistes".
Le mémoire explore la vie et les contributions de François-André Danican
Philidor, compositeur et joueur d'échecs français du XVIIIe siècle, en mettant
l'accent sur ses idées révolutionnaires concernant les échecs et leur possible
lien avec les théories musicales de Jean-Philippe Rameau. Le mémoire est
structuré en plusieurs chapitres qui couvrent la biographie détaillée de
Philidor, ses voyages, sa carrière musicale, ses idées sur les échecs, et une
analyse des influences possibles sur sa pensée, notamment les théories de
Rameau.
Benjamin Defromont examine plusieurs hypothèses pour expliquer la genèse des
idées échiquéennes de Philidor, notamment l'influence des traités d'échecs
précédents, le jeu de dames, la partie des pions inventée par le Sire de Le
Gall, et les théories musicales de Rameau.
Le mémoire inclut également des annexes contenant des documents d'archives, des
actes d'état civil, et des partitions musicales. L'objectif principal de Benjamin Defromont est de déterminer comment les
théories de Rameau ont été portées à la connaissance de Philidor et quel a été
leur impact sur sa pensée échiquéenne, tout en explorant d'autres hypothèses
pour comprendre la genèse des idées de Philidor.
En résumé, ce mémoire offre une étude approfondie de la vie et de l'œuvre de
Philidor, en mettant en lumière les intersections possibles entre la musique et
les échecs, et en explorant les influences théoriques qui ont façonné ses
idées. Il s'agit d'une contribution significative à la compréhension de
l'héritage culturel et intellectuel de Philidor.
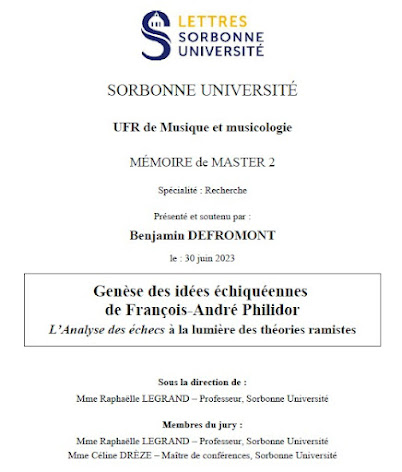
Entrevue avec Benjamin Defromont
Jean Olivier Leconte - Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Benjamin Defromont - Je m’appelle Benjamin, j’ai 22 ans, je suis maître international. J’exerce en tant qu’entraîneur d'échecs en parallèle de mes études, et je m’intéresse également à l’arbitrage et à la composition et la résolution de problèmes. À tous les aspects du jeu d’échecs, en somme !
JOL - Qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir ce sujet de mémoire sur François-André Danican Philidor et ses idées échiquéennes ?
BD - À vrai dire, je n’en sais rien ! J’avais déjà travaillé sur Philidor dans le cadre de mon prix d’histoire de la musique au C.R.R. de Lille (NDA : CRR - Conservatoire à Rayonnement Régional), et j’imagine que j’ai voulu approfondir quelque peu mes recherches. Quant à ce qui m’a amené à Philidor en premier lieu… mais ce n’est sans doute pas si fréquent de tomber sur un joueur et un théoricien des échecs de premier plan, qui occupe également une place de choix dans l’histoire de l’opéra français !
JOL - Peux-tu nous parler du processus de recherche que tu as suivi pour ce mémoire ? Quelles ont été tes principales sources d'information ?
BD - Comme c’est presque toujours le cas en sciences humaines, la plus grande partie de mon travail a consisté en l’établissement et à la lecture d’une bibliographie. En outre, puisque mon sujet était avant tout axé sur l’histoire, je me suis fréquemment rendu aux archives de Paris, pour y consulter des documents d’époque. J’ai été le premier surpris de voir que je pouvais passer des heures dans les minutes [sic] de notaire !
JOL - En quoi les contributions de Philidor aux échecs et à la musique sont-elles toujours pertinentes aujourd'hui, selon toi ?
BD - En ce qui concerne les échecs, je dirais que la réponse est simple : c’est Philidor le premier qui a compris l’importance d’avoir un objectif stratégique à long-terme. Si la construction d’un plan nous semble aujourd’hui évidente (pas dans mes propres parties, malheureusement), c’est en quelque sorte grâce à lui. Je tiens aussi à ajouter qu’il est le premier, longtemps avant l’avènement de la génération de joueurs professionnels emmenée par Steinitz et Zukertort, à avoir cherché les principes du jeu, et à avoir voulu analyser celui-ci de façon scientifique.
Pour ce qui est de la musique, les choses sont un peu plus compliquées. Le fait qu’il y ait davantage de musiciens que de joueurs d’échecs fait qu’une discipline évolue plus vite que l’autre, et comme Philidor n’a pas laissé d’écrits théoriques sur la musique, son influence n’est plus très prégnante aujourd’hui. En fait,
le Drouais fait partie des nombreux compositeurs qui ont été un peu laissés de côté par les historiens, ce qui ne veut pas dire pour autant que ses œuvres ne sont pas intéressantes ! Certains livrets qu’il a mis en musique sont même très actuels. Ce n’est pas pour rien que Julie Depardieu a consacré il y a quelques années une chronique sur France Musique aux Femmes vengées, l’un des plus grands succès du compositeur.
François-André Danican Philidor
Portrait gravé (1772) par Augustin de Saint-Aubin d'après Charles-Nicolas Cochin.
JOL - Quelles ont été les découvertes les plus surprenantes lors de tes recherches sur Philidor ?
BD - Sans hésiter, sa personnalité ! Avant de m’intéresser à Philidor, je ne connaissais de lui que quelques éléments biographiques, une ou deux parties, et les grandes lignes de ses théories échiquéennes. Au fur et à mesure de mes recherches, j’ai découvert un homme non seulement pétri de talent, mais aussi amical, généreux, sensible, et, si tant est que cela veuille dire quelque chose, profondément humain. De façon générale, apprécier la personne sur qui l’on travaille nous donne envie de redoubler d’efforts (excepté dans certaines professions, comme tueur à gages, par exemple), même s’il faut toujours veiller à garder une certaine distance critique vis-à-vis de son objet d’étude.
JOL - Philidor était à la fois un compositeur renommé et un joueur d'échecs exceptionnel. Comment parvenait-il à concilier ces deux activités ?
BD - Philidor a toujours considéré la musique comme son activité principale, sa vraie profession, en quelque sorte. Les échecs étaient pour lui avant tout un passe-temps, un « objet d’amusement sérieux » pourrait-on dire. Durant ses voyages de jeunesse, cependant, et plus tard, à partir des années 1770, c’est pourtant bien le Noble Jeu qui a pris le pas sur la musique, mais pas tant par intérêt intellectuel que par intérêt financier. À l’époque, sans assurance, sans retraite et sans revenu fixe, les compositeurs qui n’avaient pas eu la chance de trouver une place à la cour, ou au service de l’Église ou de l’aristocratie vivaient en effet dans la plus grande précarité, et c’est donc vers les échecs que Philidor a été forcé de se tourner pour assurer la subsistance de sa famille.
JOL - Comment les théories musicales de Rameau ont-elles pu influencer la pensée échiquéenne de Philidor ?
BD - Excellente question ! J’ai travaillé sur le sujet il y a deux ans déjà, et j’ai bien peur que ma mémoire me fasse défaut…. heureusement qu’il y a un autre type de mémoire auquel se rapporter !
Jean-Philippe Rameau.
Portrait attribué à Joseph Aved (1702-1766)
Musée des beaux-arts de Dijon. JOL - Philidor est souvent considéré comme un pionnier des échecs modernes. Selon toi, quelle est sa contribution la plus marquante à ce jeu ?
BD - Philidor a été le premier a véritablement tenter d’analyser les échecs. Il a été le premier à étudier un certain nombre de finales encore importantes aujourd’hui pour la théorie. Il a été le premier à se pencher en détail sur le Gambit Dame. Il a été le premier à comprendre l’importance de l’avantage d’espace et la valeur relative du matériel, même dans des positions fermées - là où Greco s’était cantonné aux positions ouvertes. Bref, il n’a été ni plus ni moins qu’un pionnier, qui a fait progresser le jeu dans toutes ses phases. Le plus important d’après moi se situe cependant ailleurs, dans la cohérence qui existe entre sa théorie et l’application qu’il en fait. Pour le dire autrement, Philidor a logicisé le jeu d’échecs.
JOL - J'ai vu qu'actuellement tu étais en thèse à l'université de Lille avec comme thème "La beauté aux échecs". peux-tu nous en parler ?
BD - Mon mémoire sur Philidor a été réalisé dans le cadre d’un master en musicologie, mais je suis avant tout un étudiant en philosophie, et mon doctorat s’inscrit dans cette dernière discipline. J’avais, durant mes deux années de master, travaillé sur la pantomime dans l’œuvre de Diderot, et j’ai voulu rester dans le champ de l’esthétique. Au vu de mon intérêt pour la composition échiquéenne, le sujet s’est presque imposé de lui-même.
Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais la première étape de mon travail a consisté à choisir la définition de la beauté que j’allais défendre, pour ensuite montrer comment elle pouvait s’appliquer aux échecs. Pour le moment, je suis assez satisfait du résultat, et, si tout se passe bien, je devrais soutenir ma thèse en juin 2026. Comme je le dis souvent aux élèves de mon cours d’histoire des échecs, il y a de nombreuses façons de s’intéresser à notre jeu : à travers les parties par correspondance, la composition, la résolution, l’arbitrage, etc..
Tous ces domaines sont autant de facettes des échecs, qui, selon moi, ne devraient pas être éclipsées par le jeu à la pendule. De ce point de vue, je regrette que les fédérations nationales ne communiquent pas davantage sur la diversité de ces pratiques, et j’espère que mes recherches permettront de mettre en évidence le caractère pluriel des échecs, et de faire découvrir de nouveaux aspects du jeu à un public qui n’en aurait peut-être jamais entendu parler autrement.
Merci Benjamin !
























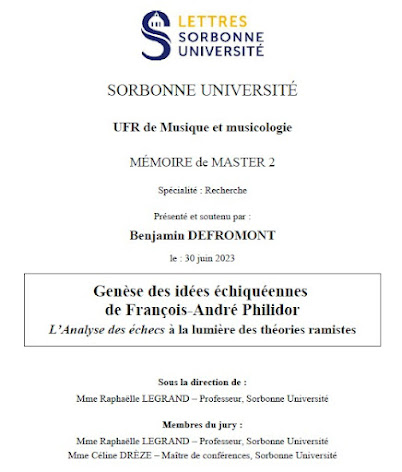

_-_001.jpg)